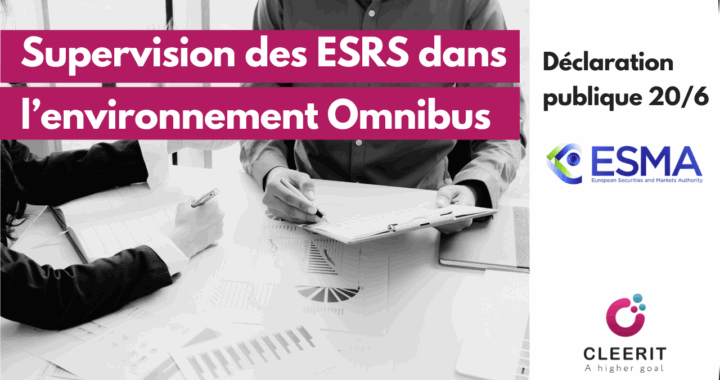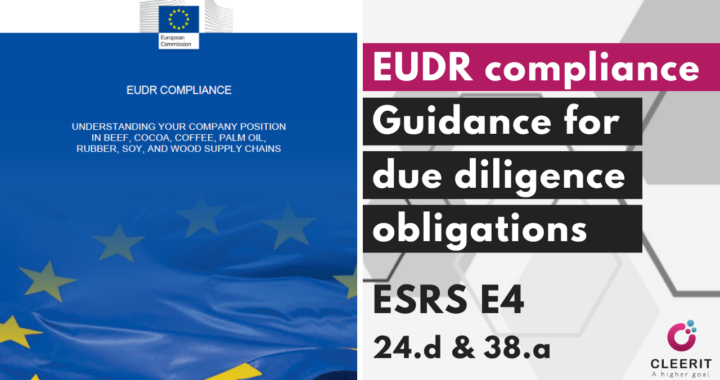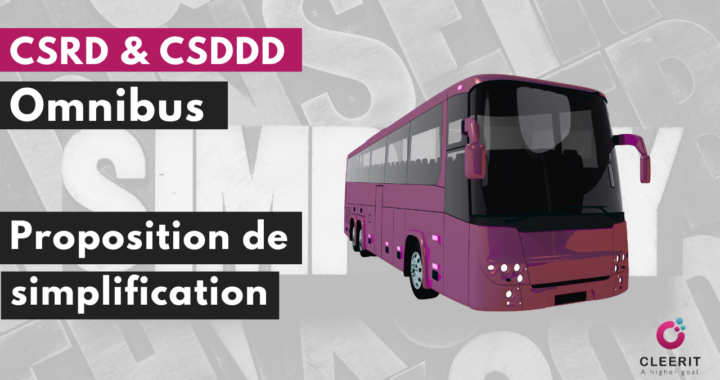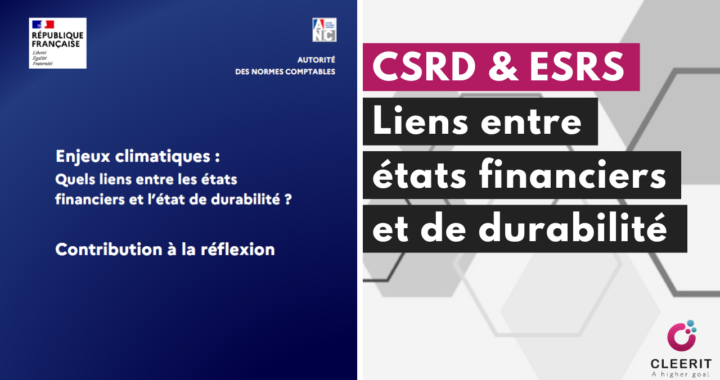Le 11 juillet, la Commission européenne a adopté l’acte délégué « Quick-Fix » avec des ajustements concernant les mesures de progressivité des exigences de publication des normes ESRS Set 1 pour les entreprises de la vague 1 ayant commencé à publier leurs informations ESRS pour l’exercice 2024 et n’étant pas concernées par la directive « Stop-the-clock ».
Ces amendements garantissent que ces entreprises n’auront pas besoin de publier d’informations supplémentaires pour les exercices 2025 et 2026 par rapport à 2024, en attendant l’adoption des ESRS simplifiées et des propositions Omnibus.
Toutes les entreprises de la première vague sont désormais autorisées à omettre les exigences suivantes pour les exercices 2025 et 2026 :
Normes introduites progressivement
-
- E4 : Biodiversité et écosystèmes
- S2 : Travailleurs de la chaîne de valeur
- S3 : Communautés affectées
- S4 : Consommateurs et utilisateurs finaux
Points de données introduites progressivement
-
- Effets financiers attendus des risques et opportunités→ SBM-3/ E1-9/ E2-6/ E3-5/ E4-6/ E5-6
- À l’exception des informations prescrites par le paragraphe 40, point b) (E2-6) concernant les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement encourues au cours de la période de reporting à l’occasion d’incidents majeurs et de dépôt
- E1-6 : Points de données sur les émissions brutes de GES des scopes 3 et émissions totales de GES
- S1-7 : Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise
- S1-14 : Données sur la santé et la sécurité des travailleurs non-salariés
- S1-8 : Négociation collective et dialogue social qui concerne ses salariés dans les pays non-membres de l’EEE
- S1-11 à 13 : Protection sociale, Personnes handicapées, Formation et développement des compétences
- S1-14 : Données relatives aux cas de maladies professionnelles et au nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès et de maladies professionnelles
- S1-15 : Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
- Effets financiers attendus des risques et opportunités→ SBM-3/ E1-9/ E2-6/ E3-5/ E4-6/ E5-6
Toutefois, les entreprises de la vague 1 qui utilisent ces mesures de progressivité temporaires pour une norme thématique complète doivent néanmoins communiquer certaines informations résumées sur l’enjeu concerné si elles concluent que l’enjeu en question est matériel, comme l’exige le paragraphe 17 de l’ESRS 2 :
- Si une entreprise ou un groupe … décide d’omettre les informations exigées par E4, S1, S2, S3 ou S4 …, elle indique néanmoins si les thèmes de durabilité couverts, respectivement, par E4, S1, S2, S3 et S4 ont été considérés comme matériels à la suite de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise. En outre, si un ou plusieurs de ces thèmes ont été jugés matériels après évaluation, l’entreprise, pour chaque thème important [lire matériel] :
- publie la liste des enjeux (c’est-à-dire des thèmes, sous-thèmes ou sous-sous-thèmes) énoncés dans l’AR 16 d’ESRS 1, appendice A, qui s’avèrent matériels après évaluation, et explique succinctement la manière dont son modèle économique et sa stratégie tiennent compte des impacts de l’entreprise liés à ces enjeux. L’entreprise peut identifier l’enjeu au niveau du thème, du sous-thème ou du sous-sous-thème;
- décrit brièvement les cibles assorties d’échéances qu’elle s’est fixées pour les enjeux concernés, ainsi que les progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces cibles, en précisant si ses cibles en matière de biodiversité et d’écosystèmes reposent sur des preuves scientifiques concluantes;
- décrit brièvement ses politiques relatives aux enjeux concernés;
- décrit brièvement les actions qu’elle a entreprises pour identifier, surveiller, prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les impacts négatifs, réels ou potentiels, liées aux enjeux concernés, et le résultat de ces actions; et
- publie les indicateurs pertinents pour les enjeux concernés.
En pratique, cela signifie donc que si votre entreprise a déjà publié des informations sur les normes thématiques E4 et S2-S4, vous pouvez continuer à les publier selon le même format, au lieu de transférer ces informations au paragraphe 17 de l’ESRS 2.
Par ailleurs, la Commission (en collaboration avec l’EFRAG) travaille à une révision plus large des normes ESRS, qui devrait être achevée d’ici l’exercice 2027.
(Attention, le tableau récapitulatif des modifications de la Commission comporte des petites erreurs : pour les normes E4, S2, S3 et S4, il faudrait lire « exercices 2025 et 2026 » et non « exercices 2025 et 2025 ».)
—
Cet acte entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE et s’applique aux exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Sources :