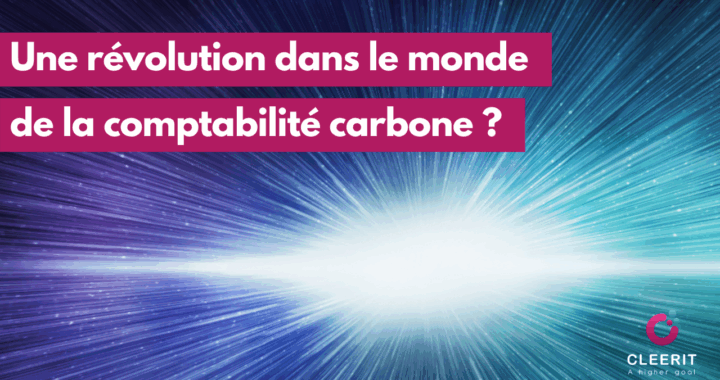La semaine dernière, le 27 octobre, Carbon Measures et la Chambre de commerce internationale (CCI) ont annoncé la création d’un panel d’experts indépendants qui élaboreront des lignes directrices et des étapes de mise en œuvre pour instaurer un système mondial de comptabilisation des émissions de carbone, basé sur les principes de comptabilité financière et la méthode des coûts par activité (ABC).
Ce concept a été développé par deux universitaires, les professeurs Robert Kaplan de l’Université Harvard et Karthik Ramanna, professeur de commerce et de politique publique, directeur du programme Transformational Leadership Fellowship à la Blavatnik School of Government de l’université d’Oxford. Publié pour la première fois dans le numéro de nov/déc 2021 de la Harvard Business Review, il a reçu le prix McKinsey 2022 de la revue pour son « approche novatrice en matière de gestion ».
Ils ont également publié un article dans la Harvard Business Review le 12 avril 2022 : « Nous avons besoin d’une meilleure comptabilité carbone. Voici comment y parvenir. »
« Il y a environ 90 ans, un petit groupe d’experts issus du monde des affaires et du milieu universitaire s’est réuni dans l’intérêt général afin de créer les PCGR s’appliquant aux comptes financiers. Leur innovation a permis aux marchés financiers de se développer comme jamais auparavant », a confié pour sa part Karthik Ramanna.
Nous en sommes aujourd’hui à un stade où un ensemble similaire de principes comptables rigoureux, technologiquement agnostiques et politiquement neutres est nécessaire pour comptabiliser les émissions de la chaîne d’approvisionnement. Appliqués correctement, ces principes permettraient au capitalisme de déployer toute sa puissance pour accélérer la décarbonation tout en favorisant l’abondance énergétique. »
Qui sont les personnes et les organisations à l’origine de Carbon Measures ?
Karthik Ramanna coprésidera le nouveau groupe d’experts techniques de Carbon Measures aux côtés de sa PDG, Amy Brachio, ancienne vice-présidente mondiale de la durabilité chez EY pendant près de trois décennies.
Carbon Measures est une coalition mondiale regroupant des entreprises de divers secteurs et pays, notamment ADNOC, Air Liquide, Banco Santander, BASF, Bayer, CF Industries, EQT Corporation, ExxonMobil, EY, Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock), Honeywell, Linde, Mitsubishi Heavy Industries et Mitsui.
Carbon Measures appelle également à une nouvelle politique « qui libère l’innovation, la concurrence et les solutions fondées sur le marché pour réduire les émissions ».
La Chambre de commerce internationale (CCI) est une organisation représentant plus de 45 millions d’entreprises dans plus de 170 pays. Elle promeut le commerce international, les pratiques commerciales responsables et une approche mondiale de la réglementation, et propose des services de résolution des litiges. Parmi ses membres figurent un bon nombre des plus grandes entreprises mondiales, des PME, des organisations professionnelles et des chambres de commerce locales.
S&P Global Commodity Insights, principal fournisseur indépendant d’informations, d’analyses, de logiciels d’infrastructure pour le marché du carbone ainsi que de prix de référence pour les marchés mondiaux des matières premières et de l’énergie, et une division de S&P Global (NYSE : SPGI), sera le partenaire de connaissances indépendant du panel. S&P Global est le principal fournisseur mondial de notations de crédit, d’indices de référence, d’analyses et de solutions de flux de travail pour les marchés mondiaux des capitaux, des matières premières et de l’automobile.
Carbon Measures sera présent à la COP30 avec le soutien de certaines des entreprises et organisations professionnelles les plus influentes au monde.
L’organisation est sponsor de la plateforme brésilienne dédiée aux entreprises, Sustainable Business COP. Le PDG de la plateforme, Ricardo Mussa, a récemment déclaré à Reuters que la réforme de la comptabilité carbone serait une priorité absolue de l’ordre du jour du sommet.
La CCI est le représentant officiel des entreprises auprès des Nations Unies pour la COP30 ; elle disposera donc d’importantes opportunités pour promouvoir le projet tout au long de l’événement.
Qu’est-ce qu’une approche de comptabilisation du carbone basé sur un grand livre (E-ledgers) ?
Cette initiative vise à transformer notre façon de comptabiliser les émissions en suivant les émissions « du berceau à la porte » intégrées aux produits et services tout au long de leur cycle de vie, et en repensant la comptabilité carbone comme un processus basé sur son flux à travers la chaîne de valeur, axé sur la capture des émissions au niveau du produit à chaque étape.
Contrairement à l’approche par processus de l’analyse du cycle de vie (ACV), lorsqu’un actif est transféré d’une entreprise à une autre, son empreinte carbone l’accompagne. Ainsi, tout comme l’actif passe d’un registre financier à un autre, son « e-passif » passe d’un grand livre d’émission (E-ledgers) à un autre.
La méthode des coûts par activité (ABC) fournit des méthodologies d’allocation rigoureuses pour affecter les émissions indirectes partagées à des produits spécifiques, un domaine où l’ACV s’appuie parfois sur des règles simplifiées.
Le suivi de la chaîne de traçabilité crée des pistes d’audit similaires à celles de la comptabilité financière, permettant potentiellement une vérification d’une qualité plus élevée.
L’accent mis sur les données spécifiques aux fournisseurs pourrait répondre à certaines préoccupations de qualité liées au Scope 3 du GHG Protocol.
Le principe « mutuellement exclusif et collectivement exhaustif » de ces grands livres d’émissions (E-ledgers) vise à éliminer les doubles comptages mathématiques en garantissant que chaque tonne de CO₂ ne soit comptabilisée qu’une seule fois lors de son transfert à travers les chaînes d’approvisionnement.
Ceci, affirment-ils, permettra d’éliminer les problèmes de double comptage : par exemple, lorsqu’une même tonne de carbone est comptabilisée par plusieurs entreprises, car elle relève du Scope 1 pour l’une et du Scope 3 pour l’autre.
La force du système E-ledgers réside dans son approche de mesure, fondée sur l’expertise comptable accumulée au fil des siècles.
Ce système, éprouvé et validé avec des indicateurs financiers, est facilement adaptable à un système basé sur les émissions.
L’entreprise n’a besoin de mesurer que ses propres émissions, ce qui permet à un auditeur externe de les vérifier aisément.
Les informations relatives aux émissions en amont sont communiquées à l’entreprise par ses fournisseurs, ce qui élimine la nécessité d’estimations et renforce la fiabilité des données.
Si toutes les entreprises d’une chaîne de valeur utilisaient des E-ledgers, elles appliqueraient la même méthode de mesure et déclareraient les émissions par produit, ce qui améliorerait la comparabilité.
Le principal inconvénient du système E-ledgers réside dans le fait qu’il exige une application par toutes les entités impliquées dans l’activité pour atteindre le seuil de « fiabilité raisonnable ».
Les entreprises doivent être disposées à coopérer et à fournir les informations nécessaires sur les émissions à l’entité suivante dans la chaîne d’approvisionnement.
Les E-ledgers nécessitent également une répartition des émissions dans le temps et entre les produits, ce qui peut soulever des questions et des problèmes comptables.
Les concepts d’E-passif (émissions) et d’E-actif (absorptions) expliqués par l’Institut E-Ledgers
L’Institut E-Ledgers est un organisme à but non lucratif axé sur l’apprentissage, qui promeut des pratiques rigoureuses de comptabilisation des émissions afin de stimuler l’innovation en matière d’efficacité énergétique à l’échelle mondiale, grâce à l’élaboration d’un ensemble de principes de comptabilisation des émissions, libre et gratuit.
L’Institut a annoncé la publication, en septembre 2024, d’un projet de norme préliminaire pour la comptabilisation et l’audit des émissions au niveau des produits, selon la méthode E-liability (E-passif).
L’E-liability est un algorithme comptable qui permet aux organisations de calculer les émissions de gaz à effet de serre intégrées à tout produit ou service, en temps quasi réel, de manière à être auditable selon les normes les plus exigeantes de la comptabilité financière.
L’approche E-liability produit, pour chaque produit et service de l’économie, une mesure précise et auditable de ses émissions totales, de l’extraction des matières premières à la sortie d’usine.
« Cela permet aux acheteurs – qu’il s’agisse d’une entreprise achetant un lot de ciment, d’un consommateur achetant un film sur sa tablette ou d’un investisseur à la recherche de son prochain projet – de visualiser l’impact total des émissions liées à la production de ce produit ou à la prestation de ce service. »
De même que les E-liability désignent les unités d’émissions de GES (dans l’atmosphère) imputables à une entité ou un produit donné, les E-actifs (E-assets) désignent les unités d’absorption de GES (de l’atmosphère) imputables à une entité ou un produit donné.
Le cadre E-assets d’E-ledgers définit les conditions dans lesquelles une action d’absorption de GES de l’atmosphère peut être reconnue comme un actif négociable dans un grand livre d’émissions (E-ledgers) et les conditions dans lesquelles un tel actif peut être utilisé pour compenser les E-passifs (afin d’établir, par exemple, la qualification de « zéro émission nette » d’une entité ou d’un produit).
Ensemble, les E-passifs (E-liability) et les E-actifs (E-asset) constituent les deux volets du cadre de la comptabilisation du carbone basé sur un grand livre (E-ledgers), un système complet de gestion des émissions et des instruments permettant de les compenser.
« La dualité des E-ledgers garantit que les organisations sont incitées et tenues responsables à la fois des émissions et des actions de réduction des émissions. »
Quelle est la principale différence entre l’approche comptabilisation du carbone basé sur un grand livre, « E-ledgers », et le GHG Protocol ?
L’approche du GHG Protocol vise à aider l’entreprise à comprendre ses sources d’émissions et met l’accent sur la transparence, tandis que les « E-ledgers » visent à créer une plateforme mondiale qui suit les émissions au-delà des frontières et entre les entités, au niveau du produit, et privilégie la responsabilisation.
Le GHG Protocol adopte une vision « top-down » (descendante)et se concentre sur la responsabilité : une entreprise mesure les émissions générées tout au long de sa chaîne de valeur (en bref, les émissions produites par le fournisseur, l’entreprise elle-même et le client).
Cette approche est introspective, car elle vise à aider l’entreprise à comprendre l’ampleur des émissions générées par ses activités. L’idée est de faire un bilan des émissions de carbone et, à partir de là, d’élaborer des stratégies pour les réduire au fil du temps.
À l’inverse, les « E-ledgers » adoptent une approche « bottom-up » (ascendante) et se concentrent sur le contrôle : une entreprise mesure les émissions intégrées aux produits ou services qu’elle possède et vend (émissions « du berceau à la porte »).
Avec l’approche des « E-ledgers », les acheteurs sont tenus responsables des émissions, mais beaucoup moins les vendeurs.
C’est probablement la raison pour laquelle l’industrie pétrolière et gazière s’y intéresse. Contrairement à la comptabilisation traditionnelle des émissions du Scope 3 du GHG Protocol, l’approche des « E-ledgers » n’oblige pas les entreprises à assumer la responsabilité des émissions produites par leurs produits vendus.
Exxon, l’un des membres fondateurs de la Carbon Measures, a déjà exprimé très clairement son opinion sur le GHG Protocol, le qualifiant de « norme de reporting défaillante » dans une action en justice intentée la semaine dernière contre les exigences de transparence climatique de la Californie.
Le géant pétrolier ne souhaite pas être contraint par les autorités de réglementation d’adopter des aspects du cadre qu’il désapprouve, a-t-il expliqué, « tels que l’obligation de publier les recalculs des émissions de l’année de référence et l’obligation de publier l’ensemble des émissions de Scope 3 ».
D’autres, cependant, soutiennent que l’approche de mesure du GHG Protocol permet aux investisseurs de comprendre le risque inhérent à l’ensemble de la chaîne de valeur d’une entreprise et de créer une « responsabilité collective face à un problème collectif ».
Toutefois, la fiabilité est une préoccupation. Les chiffres reposent sur des facteurs d’émissions publics qui peuvent ne pas être adaptés à la situation de l’entreprise.
Les chiffres présentés sont des estimations de la direction et peuvent comporter des marges d’erreur importantes (l’entreprise n’ayant souvent pas accès aux données réelles sur les émissions, notamment celles liées à l’utilisation de ses produits par les clients).
La vérifiabilité pose également problème. Si les estimations peuvent être auditées, cet audit sera généralement limité et se concentrera sur la vérification des calculs de la direction, et non nécessairement sur l’exactitude des informations relatives aux émissions.
Ces difficultés peuvent rendre difficile la confiance dans les informations fournies, du point de vue des parties prenantes externes, et susciter des inquiétudes quant à une divulgation sélective.
Le partenariat entre le GHG Protocol et ISO (14067)
Le monde de la comptabilité carbone évolue rapidement. Le 9 septembre 2025, ISO et GHG Protocol ont annoncé leur intention d’harmoniser leurs normes relatives aux GES et de codévelopper de nouvelles normes pour la mesure et la publication des émissions de GES.
Il s’agit d’une avancée majeure vers un langage mondial plus commun pour la comptabilité des émissions, reconnaissant implicitement des obstacles existants dans l’approche actuelle.
La norme d’entreprise GHG Protocol a été développée sur plus de 25 ans et elle est adoptée par 97 % des entreprises du S&P 500 présentes à l’international. Elle est actuellement intégrée aux normes de durabilité ISSB/IFRS-S et ESRS de l’UE.
La force fondamentale de GHG Protocol réside dans une responsabilisation exhaustive.
En exigeant des entreprises qu’elles publient leurs émissions directes (Scope 1), leurs émissions liées à l’énergie achetée (Scope 2) et leurs émissions liées à la chaîne de valeur (Scope 3), il garantit que les entreprises assument la responsabilité des émissions sur lesquelles elles ont une influence, mais qu’elles ne contrôlent pas directement.
Cependant, bien qu’encourageant l’utilisation de données primaires, le reporting Scope 3 s’appuie souvent sur des moyennes sectorielles et des méthodes d’estimation, ce qui limite la précision et la vérifiabilité.
Le GHG Protocol est également confronté à des défis légitimes concernant la granularité des données au niveau du produit et la qualité des données Scope 3. Bien que la norme de produit du protocole existe, elle n’est pas encore largement adoptée.
La norme ISO 14067, basée sur les principes de l’analyse du cycle de vie (ACV) et intégrant une méthodologie d’empreinte carbone produit, fournit un cadre systématique pour évaluer les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d’un produit, de l’extraction des matières premières à la production, l’utilisation et l’élimination.
Le partenariat entre GHG Protocole et ISO vise à harmoniser ces deux approches tout en développant des normes améliorées pour l’empreinte carbone des produits, afin de parvenir à un langage mondial plus commun pour la mesure et le reporting des émissions.
L’initiative Carbon Measures remplacera-t-elle ou complétera-t-elle les systèmes existants ?
Dans un article publié le 8 octobre 2025, Robert G. Eccles soutient que le partenariat entre le GHG Protocol et ISO crée une infrastructure de données précises au niveau du produit, dont les mécanismes de tarification du carbone ont de plus en plus besoin, qu’il s’agisse d’ajustements carbone aux frontières, d’approvisionnement différencié en carbone ou de systèmes internes de tarification du carbone.
Eccles affirme également que la précision des E-ledgers au niveau du produit pourrait permettre des mécanismes de tarification du carbone plus sophistiqués, mais que l’intérêt théorique des E-ledgers « repose sur une chaîne de suivi des émissions continue et sans interruption, des matières premières à l’utilisateur final », ce qui est « quasiment impossible ».
Il soutient que « les chaînes d’approvisionnement modernes sont intrinsèquement complexes et fragmentées, impliquant des milliers d’acteurs à travers les frontières nationales, des juridictions réglementaires divergentes et des capacités technologiques variables ».
Cela conduirait à une adoption partielle, créant des modes de défaillance critiques : rupture de la chaîne de traçabilité, problèmes d’interopérabilité et impossibilité de réaliser des audits, car les auditeurs ne peuvent se prononcer sur des chaînes incomplètes.
Il conclut que « la nécessité d’une adhésion quasi universelle pour que les E-ledgers fonctionnent demeure un obstacle majeur, voire insurmontable, à leur mise en œuvre concrète ».
Et que « dans l’intérêt des utilisateurs, la seule approche réaliste est une approche collaborative. Les principes de calcul des coûts par activité des E-ledgers pourraient améliorer la façon dont l’analyse du cycle de vie (ACV) alloue les ressources partagées et les émissions indirectes à des produits spécifiques, en améliorant la précision sans remplacer le cadre sous-jacent.
Concernant les émissions en aval, les producteurs continueraient de publier les impacts estimés de la phase d’utilisation conformément aux exigences de publication des cadres du GHG Protocol, maintenant ainsi la responsabilité quant aux choix de conception des produits, même si le suivi au niveau du produit montre des transferts vers les clients. Cela préserve une responsabilité climatique globale tout en améliorant la précision des données en amont. »
Selon Eccles, « si les E-ledgers entrent en concurrence avec le partenariat Protocole GES/ISO au lieu d’y contribuer, les conséquences pour la tarification du carbone (et la décarbonation des entreprises) seraient graves. »
« Cela créerait des méthodologies incompatibles et une confusion accrue. Les entreprises seraient confrontées à des choix impossibles, les organismes de réglementation ne pourraient pas élaborer de politiques cohérentes et les mécanismes de tarification du carbone manqueraient de données standardisées. Le développement parallèle de plateformes technologiques, de procédures d’assurance, de formations professionnelles et de cadres réglementaires détournerait des ressources limitées de l’action climatique vers une concurrence méthodologique. »
Conclusion
Le lancement de Carbon Measures, qui fonde la comptabilité carbone sur les principes de la comptabilité financière, peut être considéré comme un tournant majeur dans le domaine de la comptabilité carbone, à une époque où la responsabilité en matière de durabilité se heurte à de fortes résistances politiques.
Compte tenu des tendances actuelles en matière d’ESG, des acteurs influents à l’origine de l’initiative Carbon Measures, du coût et de la complexité de la comptabilité carbone Scope 3 du GHG Protocol, et du fait que la méthode de ce protocole sera contestée devant les tribunaux, le discours de Carbon Measures visant à permettre « à plein régime le capitalisme d’accélérer la décarbonation tout en favorisant l’abondance énergétique » semble en phase avec l’air du temps.
Je ne serais pas surprise si l’obstacle, perçu comme insurmontable, à sa mise en œuvre concrète, ne s’avérait finalement pas si insurmontable que cela.
Leila Hellgren
Co-fondateur Cleerit
Sources (et pour en apprendre plus sur le système E-ledgers) :
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5441754
https://hbr.org/2022/04/we-need-better-carbon-accounting-heres-how-to-get-there
https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/26-004_2a839768-5736-4b08-97c6-bac7e72c71c7.pdf
#CSRD, #ESRS, #CarbonAccounting, #CarbonMeasures, #E-Ledgers, #GHGProtocol