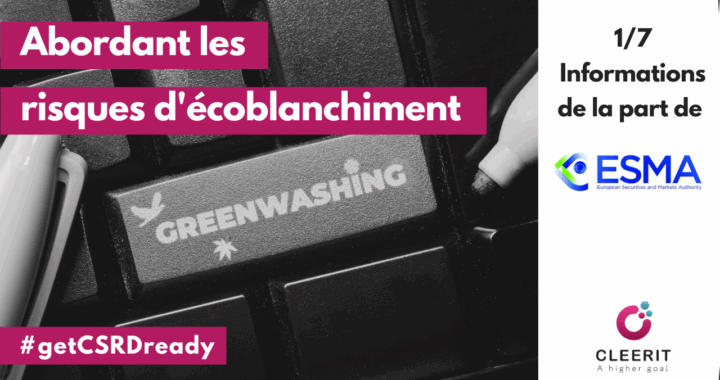Le 1er juillet, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers, ESMA, a publié des notes thématiques sur les déclarations claires, justes et non trompeuses en matière de durabilité, abordant les risques d’écoblanchiment en faveur des investissements durables.
Ces informations sont précieuses pour toute entreprise rédigeant un rapport de durabilité, qu’il soit conforme aux normes ESRS ou à la norme VSME.
Vous retrouverez ci-dessous un résumé de ces recommandations, traduites en français par nos soins (traduction non-officielle).
Conformément aux travaux menés par l’ESMA sur l’écoblanchiment, qui ont permis d’observer des pratiques positives et négatives, l’objectif est de :
- expliquer et clarifier les attentes de l’ESMA envers les acteurs du marché lorsqu’ils formulent des déclarations de durabilité ;
- rappeler aux acteurs du marché leur responsabilité de ne formuler des déclarations que dans la mesure où elles sont claires, justes et non trompeuses.
Les acteurs du marché doivent se familiariser avec les quatre principes ci-dessous relatifs aux déclarations de durabilité afin de garantir que toutes les déclarations sont claires, justes et non trompeuses et ainsi éviter le risque d’écoblanchiment.
Les allégations trompeuses peuvent notamment prendre la forme de déclarations sélectives favorisant les « cerises sur le gâteau », d’exagérations, d’omissions, d’imprécisions, d’incohérences, d’absence de comparaisons ou de seuils significatifs, d’images ou de sons trompeurs, etc.
Les quatre principes à suivre sont, en résumé :
1) Exactitude
Les allégations de durabilité doivent représenter fidèlement et précisément le profil de durabilité de l’entité, sans exagération et en évitant les faussetés.
Les allégations doivent être précises et fondées sur tous les aspects positifs et négatifs pertinents.
Les omissions et les déclarations sélectives doivent être évitées.
Les allégations doivent éviter toute imprécision et toute référence excessive à des informations non pertinentes ou non contraignantes.
2) Accessibilité
Les allégations de durabilité doivent s’appuyer sur des informations faciles d’accès et de consultation par les lecteurs, et présenter un niveau de détail approprié pour être compréhensibles.
Les allégations ne doivent pas être trop simplistes, mais doivent être faciles à comprendre.
3) Justification
Les allégations de durabilité doivent être étayées par un raisonnement, des faits et des processus clairs et crédibles.
La justification doit reposer sur des méthodologies (comparaisons, seuils ou hypothèses sous-jacentes) justes, proportionnées et pertinentes.
Les limites des informations, données et indicateurs utilisés dans une déclaration doivent être rendues publiques.
Les comparaisons doivent clarifier l’objet de la comparaison, la méthode de comparaison et, si possible, comparer des éléments comparables.
4) Actualisation
Les déclarations de durabilité doivent s’appuyer sur des informations actualisées, tout changement important devant être communiqué en temps utile.
L’indication claire de la date et du périmètre de l’analyse peut être utile à cet effet.
Références ESG
ESMA souligne également que l’utilisation de références ESG figurent parmi les déclarations les plus fréquemment utilisées dans les communications destinées aux investisseurs particuliers.
Il s’agit notamment de références à des qualifications, des labels, des notations et des certificats (et elles peuvent être trompeuses à plusieurs égards).
Par exemple, en surestimant l’importance d’un label donné, de l’obtention d’un prix ESG, de la signature d’un cadre volontaire, etc.
Clarifiez si les critères sous-jacents des labels se concentrent uniquement sur la mise en place de processus et/ou s’ils exigent également l’obtention de résultats positifs spécifiques en matière de durabilité.
Soyez transparent sur la gouvernance du processus de l’organisme certificateur, les critères d’éligibilité, la date des différentes versions ou mises à jour et précisez si le label/prix est composé de sous-catégories.
Lorsque vous utilisez un titre attribué par des entités susceptibles de vendre des services payants, clarifiez tout conflit d’intérêts potentiel et tout paiement de frais aux entités attributaires (par exemple, si votre entité était sponsor du prix ESG).
Précisez la période pour laquelle le prix ESG a été attribué et la date de sa réception.
Retrouvez ici la note thématique complète de l’ESMA (en anglais), avec les choses à faire et à ne pas faire :
#getCSRDready, #CSRD, #ESRS, #ESG, #Stratégie, #Gouvernance, #GestionDesRisques #RapportDeDurabilité, #Cleerit