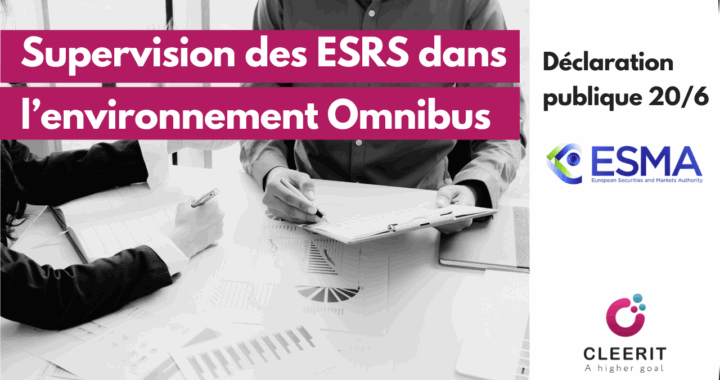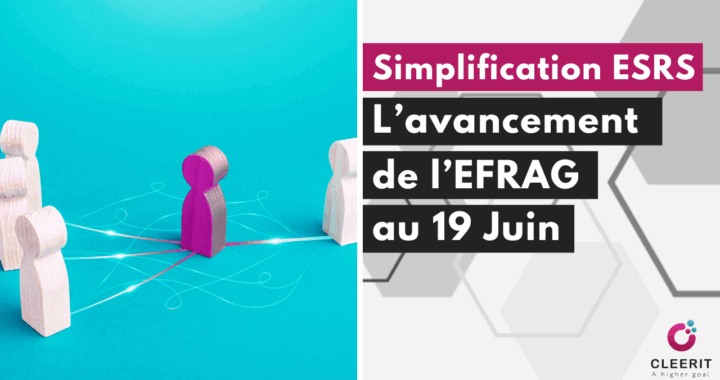Compte tenu de l’incertitude engendrée par la première application des normes ESRS, une transposition inégale de la CSRD et les propositions Omnibus, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié le 20 juin une déclaration publique intitulée « Faire face au changement ensemble : la supervision des ESRS dans l’environnement Omnibus ».
Cette déclaration confirme l’engagement de l’AEMF et des autorités nationales compétentes à promouvoir un reporting transparent en matière de durabilité, notamment pour atténuer le risque d’écoblanchiment.
Lignes directrices de l’AEMF pour l’application des informations en matière de durabilité (GLESI)
Les lignes directrices de l’AEMF pour l’application des informations en matière de durabilité (GLESI), applicables depuis janvier 2025, fournissent un cadre commun fondé sur des principes pour superviser le reporting en matière de durabilité conformément à la CSRD et aux ESRS.
Les GLESI aideront les autorités chargées de l’application à détecter d’éventuelles infractions dans les informations en matière de durabilité, par exemple d’éventuels problèmes d’écoblanchiment.
L’AEMF reconnaît que les premières années d’application des ESRS impliqueront une courbe d’apprentissage pour toutes les parties, nécessitant une période d’adaptation pour parvenir à une compréhension commune des nouvelles exigences.
L’application du GLESI durant cette phase devra être proportionnée et réaliste, en mettant l’accent sur le soutien, le dialogue, les améliorations et, si nécessaire, les mesures correctrices.
Il est important d’appliquer le GLESI dès la première année d’examen des états de durabilité établis en application des ESRS par les autorités de contrôle, afin de garantir une approche d’application convergente dès la première année.
La CSRD vise à rendre le statut des informations de durabilité comparable à celui des informations financières. L’expérience pratique de l’application des ESRS permettra aux autorités de contrôle d’affiner leurs processus et leurs ressources.
Les autorités de contrôle doivent réagir de manière cohérente en cas de détection d’infractions au cadre d’information sur la durabilité.
On s’attend généralement à ce que les états de durabilité des émetteurs sélectionnés selon une sélection fondée sur les risques présentent une probabilité plus élevée de contenir des infractions.
Une sélection fondée sur les risques devrait donc être utilisée pour au moins 50 % des émetteurs dont les autorités de contrôle des informations de durabilité examinent.
Approches pour faire respecter les informations de durabilité
Les autorités de contrôle doivent identifier la manière la plus efficace de faire respecter les informations de durabilité.
Ils peuvent utiliser quatre approches différentes pour examiner les informations de durabilité, qui diffèrent selon deux paramètres :
- la communication de l’autorité de contrôle avec l’émetteur pendant l’examen (examen interactif ou examen sur ordinateur) ;
- la base de son examen sur l’intégralité ou une partie des informations de durabilité (examen illimité ou examen ciblé).
Les examens interactifs illimités doivent être utilisés pour au moins 33 % des examens, ou couvrir au moins 10 % du nombre total d’émetteurs concernés par ce type d’examen.
Les infractions pouvant, par définition, avoir un impact sur les décisions prises sur la base des informations de durabilité, il est important que les informations corrigées soient publiées, sauf impossibilité pratique, en temps opportun.
Lorsqu’une infraction est détectée, l’autorité de contrôle doit prendre au moins l’une des mesures suivantes :
- exiger une nouvelle publication de l’état de durabilité ;
- exiger une note corrective ; ou
- exiger une correction dans le futur état de durabilité avec retraitement des données comparatives, le cas échéant.
Lorsqu’un écart non matériel par rapport au cadre d’information en matière de durabilité est intentionnellement laissé sans correction afin d’obtenir une présentation particulière de l’émetteur, l’autorité de contrôle doit prendre les mesures appropriées comme s’il était matériel.
Les autorités de contrôle doivent rendre compte périodiquement de leurs activités de contrôle au niveau national et fournir à l’AEMF les informations nécessaires à la communication et à la coordination des activités de contrôle menées au niveau européen.
Huit États membres n’ont actuellement pas transposé la CSRD en droit national : l’Autriche, Chypre, l’Allemagne, l’Espagne, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et le Portugal.
Pour ces États membres, l’approche des autorités nationales compétentes en matière de surveillance du reporting en matière de durabilité consistera à continuer d’exercer leur mandat de surveillance conformément au droit national en vigueur.
Bien que ces autorités nationales ne puissent pas déclarer officiellement leur conformité avec la GLESI, elles appliqueront des procédures comparables, conformément aux orientations de l’AEMF sur l’information en matière de durabilité.
Groupe Européen de travail sur le reporting en matière de durabilité (SRWG)
Afin d’atteindre un niveau élevé d’harmonisation dans le contrôle, les autorités de contrôle devraient discuter et partager leur expérience sur l’application et le respect du cadre d’information en matière de durabilité lors des réunions du groupe de travail sur le reporting en matière de durabilité (SRWG).
L’objectif de ces discussions au sein du SRWG est de permettre la coordination européenne des activités nationales d’application de la loi et, pour cette raison, tous les responsables de l’application de la loi devraient envoyer des représentants à ce groupe.
Téléchargez la déclaration complète ici (en anglais) : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-06/ESMA32-992851010-2254_Statement_on_the_ESRS_supervision_in_the_Omnibus_environment.pdf
Les lignes directrices de l’ESMA pour l’application des informations sur la durabilité (GLESI), applicables depuis janvier 2025, peuvent être téléchargées ici : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-12/ESMA32-992851010-1016_Consultation_Paper_on_Guidelines_on_Enforcement_of_Sustainability_Information.pdf
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rendre plus efficaces votre stratégie, votre gouvernance et vos processus de reporting ESG, et atteindre une conformité totale avec les normes ESRS : www.cleeritesg.com
#getCSRDready, #CSRD, #ESRS, #ESG, #Stratégie, #Gouvernance, #ÉtatDeDurabilité, #Digitalisation, #Cleerit